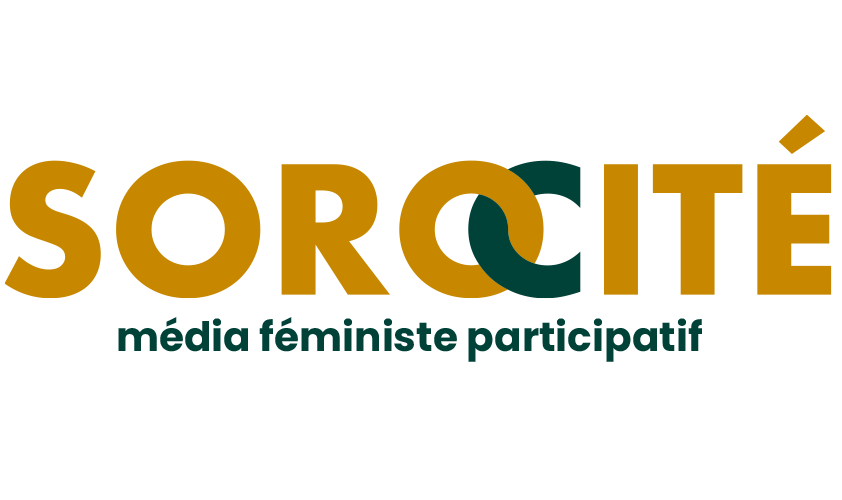Par La Rédaction
| Chez Sorocité, on se demandait depuis plusieurs semaines comment aborder la question du cancer du sein, comment parler d’Octobre Rose : réunir des témoignages, compiler des statistiques, rencontrer un·e médecin oncologue ? Et finalement, en parlant ensemble, on s’est rendu compte que ce qui était pour nous la maladie de nos mères et de nos grands-mères n’était plus si loin de nous. À table ce jour-là, Morgane nous a confié avoir des prédispositions génétiques, être porteuse d’une mutation sur le gène BRCA2. Un héritage médiatisé par Angelina Jolie, qui avait réalisé une mastectomie préventive en 2013 après la découverte de l’altération chez elle du gène BRCA1. Loin du tapis rouge, Morgane a écrit sur « son cancer du sein fantôme », comment elle a appris la nouvelle, et ce que ça implique pour elle. |
| *** J’ai appris que mon père était malade en 2016. je me débattais déjà avec les émotions contradictoires que cette information suscitait chez moi quand il m’a dit qu’il fallait que je vérifie si moi aussi, je risquais très fort de tomber malade. C’est parce que le service qui le suivait avait pensé enfin à interroger la génétique familiale qu’on a détecté le gène déviant, une mutation sur le BRCA 2. Étant la seule fille de mon père je devais être moi aussi testée urgemment. Le risque de cancer du sein passait de 1 chance sur 8 à partir de 50 ans pour le commun des mortelles, à 1 chance sur 2 à partir de 30 ans si j’étais moi aussi porteuse de la mutation. J’en avais à peine 25 mais il fallait se préparer. J’ai découvert mon arbre généalogique. Ma grand-mère qui, avant la tumeur aux ovaires qui a fini par l’emporter à 81 ans, avait eu un cancer du sein dont personne ne m’avait parlé. Mon arrière grand-mère, morte d’un cancer du sein à trente-neuf ou quarante ans, un grand-oncle, une grand-tante, plusieurs arrières-grand-tantes, des noms en fluo à chaque étage de l’arbre jusqu’à ceux dont on ne connaît pas ou plus les parcours médicaux. L’ampleur du silence sur une maladie familiale, dont chacun sait qu’elle s’hérite, mais dont personne ne m’avait parlé. J’avais toujours répondu « aucun » à toutes les gynécos qui me demandaient mes antécédents, « sauf ma grand-mère paternelle mais elle avait quatre-vingts ans ». J’ai trouvé ça absurde. Méchant. Inutile et égoïste. Ridicule. Dangereux. Si mon père n’avait pas été malade, je n’aurais jamais su. Je me suis sentie trahie par les femmes de ma famille. J’en veux aussi à mon père bien sûr. Je m’en veux, de ne pas avoir assez relayé cette question des antécédents familiaux, mais est-ce que vraiment je ne l’ai pas fait ? Il me semble aujourd’hui que si, j’ai interrogé ma mère. Peut-être pas mon père. C’est lui qui aurait dû avoir les réponses. Il me semble aussi avoir entendu cette phrase « je pensais que tu savais », mais je ne sais plus dans la bouche de qui. Qui m’aurait dit ? Qui m’aurait appris que la branche paternelle était termitée de cancers hormonaux ? Qui a pu imaginer que mon père puisse faire ce travail d’information ? Où était la transmission de femmes à femmes dans ces deux familles obsédées par leurs hommes disparus, mes deux grands-pères que je n’ai pas connus ? J’ai eu un premier rendez-vous début 2017, pour m’expliquer ce qui allait suivre: un test ADN, grâce à une prise de sang, et ensuite rien, si le test était négatif, ou un rendez-vous par an à partir de mes trente ans, si le test était positif. Le jour de l’annonce du résultat, j’ai attendu l’oncologue. Je me souviens qu’il était en retard mais je ne sais plus de combien de temps. J’étais seule. Il a fini par ouvrir la porte de son bureau et m’appeler. Je suis entrée, deux jeunes femmes étaient assises contre le mur de droite de la pièce qui était très petite. Elles avaient des blouses mais je n’ai jamais su qui elles étaient. Je crois qu’elles m’ont dit bonjour. L’oncologue s’est assis, je n’avais pas encore eu le temps de me défaire de mon sac et de la veste que je portais et déjà « bon bah, vous avez le même gène que votre papa ». J’en ai encore les oreilles qui sifflent. Il me reste de ce moment cette pensée – je n’étais pas encore assise. Comme si le médecin avait voulu évacuer l’information centrale, s’en détacher pour que l’on se concentre sur la suite, quoi faire à présent. Ne pas avoir à se dépatouiller de l’impact de l’annonce. En faire du rien, du négligeable, de l’anodin. Je n’ai pu que poser la seule question à laquelle j’avais pensé avant le rendez-vous – est-ce que j’allais pouvoir continuer de donner mon sang. Il a été surpris, et m’a dit « non, par précaution ». Il n’a jamais cherché de réponse plus précise que ce « par précaution ». Je suis sortie de l’hôpital en flottant, sans savoir quoi penser. Je devais retourner travailler mais j’ai marché un peu. J’ai mangé un mauvais sandwich et une tartelette à la framboise. J’ai écrit à ma mère pour lui dire que le test n’était pas bon, elle n’a pas compris tout de suite de quoi je parlais. J’ai reposé la question du don du sang cette année, par mail. Je sais que c’est le même oncologue qui a répondu qu’il n’y avait pas de contre-indication. Toujours sans explication. J’ai donc eu trente ans en août 2022 et j’ai reçu ma première convocation pour les examens annuels en juin ou en juillet, pour la fin du mois d’août. Trois rendez-vous : une IRM (+/- échographie, en fonction du besoin), une mammographie, et un rendez-vous avec la gynécologue du service de génétique qui me suit, sur deux jours différents, en semaine, alors que je devais d’un jour à l’autre commencer un nouveau job. La bienveillance incroyable des infirmières en radiologie m’a émue. Manier un corps et la personne qui l’habite sans les brusquer, c’était possible. Chaque geste était précédé d’une interrogation, d’une mise en garde, d’une remarque rassurante. J’étais un peu fébrile, perdue dans les méandres d’un hôpital où l’on pense un peu aux patients avec un marquage au sol clair « suivez la ligne bleue jusqu’au bout à gauche », qui nous permet d’être à peu près à l’heure aux différents examens. Mais déjà il fallait vérifier. L’IRM avait montré une construction étrange dans mon sein gauche que l’échographie avait confirmée. Le même sein qui portait déjà un fibroadénome, bénin, qui m’avait fait une peur bleue en 2019. Les docteures ont pris le relais des infirmières, il faudrait une biopsie. Je n’avais pas imaginé que la nuance entre micro et macro se mesurait en largeur d’aiguille, en bruit de moteur et en taille et longévité d’hématome. Qu’il y aurait un tunnel creusé dans mon sein gauche anesthésié et qu’il faudrait ensuite, tant que le tunnel était ouvert, placer un petit croisillon en métal qui marquerait l’endroit, pour les prochaines fois, et programmer une mammographie de contrôle pour pouvoir comparer. Mon sein est resté bleu un mois, mais ce n’était rien. J’ai juste un sein trop dur. Un sein dont j’ai le choix de me débarrasser avant qu’il ne soit malade, en même temps que de l’autre. Pour se libérer des rendez-vous annuels, la seule alternative est de prendre les devants en choisissant la chirurgie préventive. Un parcours de six mois (au moins) pour inclure la reconstruction, qui paraît-il est plus esthétique qu’après avoir été malade : on n’enlève pas le mamelon et le sein ressemble toujours à un sein. Lorsque la question m’a été de nouveau posée cette année, j’ai répondu à peu près cela : je n’y ai pas encore réfléchi assez pour dire oui ou non mais, pour le moment, le parcours tel qu’on me l’a décrit me semble très contraignant alors qu’il reste une chance sur deux que je ne sois jamais malade. Ça me paraît trop lourd, pour l’instant, pour me soigner de rien. |